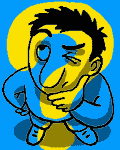|
33,
rue Raffet |

|
Nobel
d'économie et
19 novembre
2001 Les Américains George A Akerloff, A Michael Spence et Joseph E Stiglitz ont reçu conjointement le Prix Nobel d'économie le 11 octobre dernier. L'Académie royale de Suède a voulu récompenser les travaux "sur les marchés avec asymétrie d'information", qui permettent d'envisager comment certains agents détiennent plus d'information que d'autres, et les conséquence de cette situation. Ce concept est souvent utilisé en économie de la santé, que ce soit pour modéliser la relation entre assurance et patient, entre médecin et patient…
Les travaux primés ont été réalisés dans les années 1970. Ils partent de l'étude des relations bilatérales, qui constituent le fondement de la vie économique, et rompent en cela avec la théorie de l'"équilibre général" qui prédominait jusque là. Plus réalistes, les concepts ont pu être appliqués à de nombreux secteurs. La littérature sur les asymétries d'information part de la situation où un offreur bénéficie d'une information privilégiée, ce qui peut rendre la transaction impossible. En effet, les acheteurs, incertains sur la qualité du produit, ne désirent s'engager que sur des prix faibles, auxquels les vendeurs offrant des produits de bonne qualité ne veulent pas répondre. Ce problème peut par exemple concerner les voitures d'occasion. La réflexion sur les asymétries d'information et les contrats consiste à trouver les clauses contractuelles permettant de conclure des transactions dans un tel contexte. Par exemple, pour rassurer les acheteurs, il peut être possible pour les offreurs de signaler de façon crédible les caractéristiques de leur offre. En matière d'assurance, un autre type de solution est valable : les offreurs de contrats, ignorant le risque réel présenté par les demandeurs, peuvent leur offrir une gamme de contrats qui les incite à "révéler" leurs caractéristiques (leur risque) selon les choix qu'ils feront. Le principe est de construire des contrats combinant des niveaux différents de prime et de franchise afin de conduire les individus à se classer en fonction de leur risque. Mais dans de nombreux cas, il n'est pas possible de définir les termes d'un contrat qui réponde au problème de "sélection adverse" (non visibilité sur les caractéristiques de l'offre, sur sa qualité) et qui rende l'échange possible. La théorie montre alors le rôle des organisations et des intermédiaires. Un donneur d'ordre ou un intermédiaire acquiert l'information et contrôle le comportement d'un ou plusieurs agents pour rendre les transactions possibles. Dans ce cadre, les développements théoriques ont notamment porté sur le comportement et la régulation des institutions financières. Dans une certaine mesure, un "pont" a pu être établi avec la macro économie qui étudie les grands agrégats (consommation, chômage…), les asymétries donnant des "fondements micro économiques" à la macro économie. Dans cette perspective, les déséquilibres macro économiques ne sont pas le résultat d'obstacles au libre fonctionnement du marché, mais la conséquence d'un ensemble d'actions micro économiques marquées par les asymétries d'information. Ainsi, la théorie du "salaire d'efficience" explique que l'incapacité à contrôler la contribution des salariés incite à fixer leur rémunération au-dessus du niveau d'équilibre (pour attirer des salariés performants, ou pour motiver les salariés qui sont reconnaissants ou qui ont peur de perdre un emploi bien payé), ce qui engendre le sous emploi.
Le
concept d'asymétrie d'information est applicable à
toute relation de coopération entre agents. Les économistes
parlent souvent de "relations d'agence" pour décrire
les relations de coopération. Celles-ci sont marquées
par des problèmes de sélection adverse ("quelles
sont les caractéristiques de l'agent A, sa qualité ?"
se demande B), et d'aléa moral (l'agent n'a pas une visibilité
totale sur l'action d'un autre agent auprès duquel il projette
d'acheter, ou a acheté, une prestation : "que fera,
ou que fait réellement l'agent A ?" se demande
B) qui sont en grande partie issus des asymétries d'information.
Un grand nombre de relations d'agence ont été décrites
en santé. Elles impliquent la tutelle, le ou les payeurs,
les producteurs de soins, les patients.
De façon logique, l'assurance santé a été étudiée du point de vue des asymétries d'information. L'assurance ne connaît pas le risque réel des assurés : elle a intérêt à essayer de mieux le connaître et à ajuster les primes en fonction (administration de questionnaires sur l'état de santé par exemple), ou à proposer des contrats différents qui classent les assurés (ils révèlent alors leur information). En sens inverse, l'assuré peut ne pas avoir toute la visibilité souhaitable sur l'assurance. Les assurés patients attendent de l'assurance qu'elle mette en place à moindre coût des programmes de soins efficaces. Ils sont donc intéressés par des informations sur les caractéristiques et la qualité des assurances (par exemple, un assuré américain se demande si telle assurance a contracté avec tel spécialiste réputé qui prend en charge la maladie dont il est atteint), ainsi que sur l'action des assurances (il se demande si l'assurance lui laissera facilement consulter ce spécialiste).
Une autre relation d'agence importante en santé est celle qui confronte le patient et le médecin. Le patient peut cacher certaines choses au médecin : mauvaise observance du traitement, prise d'un autre médicament... En sens inverse, la relation entre le patient et le médecin met elle aussi en jeu la sélection adverse et le risque moral. Tout d'abord, le patient désire de l'information sur le producteur lui-même. Le diplôme de docteur en médecine implique une qualité minimum. Mais cet indicateur ne détaille pas des degrés de compétence, le patient ne sait pas a priori, par exemple, si tel médecin va le conseiller efficacement pour gérer sa maladie. Le patient ne connaît pas toujours le tarif de consultation, et peut ne le découvrir qu'à l'issue de la rencontre avec le professionnel… Concernant le risque moral, il faut avoir à l'esprit tout ce qui est attendu du médecin par le patient : soins, conseil et information sur le système de santé, révélation de ses besoins… Or l'ignorance face au médecin dépasse celle du profane face à un expert producteur de services, car le patient juge difficilement le résultat ex post, et notamment le rôle joué par le médecin dans ce résultat. Le patient a du mal à contrôler et à évaluer l'action du professionnel de santé. Parfois, certains patients peuvent sortir du cabinet dentaire en se demandant "le dentiste devait-il dévitaliser la dent ? Ne pouvait-il pas faire un amalgame ?"... sans pouvoir répondre à la question.
|
|
|||||||||||||||
| ss | 1 | |||||||||||||||
|
Copyright © Medcost 2003-Tous droits réservés. |
||||||||||||||||