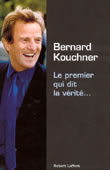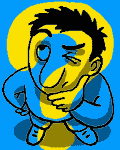|
33,
rue Raffet |

|
Le
premier qui dit la vérité
6
novembre 2002 Après Marie-Noëlle Lienemann, et Sylviane Agacinski, c’est au tour de Bernard Kouchner de livrer ses réflexions sur les causes de l’échec du candidat Jospin. Dans un ouvrage d’entretiens réalisés avec Eric Favereau, le chef de la rubrique santé de Libération, à paraître en novembre, l’ancien ministre délégué à la santé revient plus largement sur les succès, les échecs et les regrets rencontrés au cours de ces 10 dernières années, ayant été à trois reprises au gouvernement depuis 1992. Empruntant son titre à une chanson de Guy Béart, le ton est donné : "Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté… Après sans problème parle le deuxième". Manière d’envier le statut de Jean-François Mattéi, ministre de plein exercice, libre de toute tutelle et d’inscrire certaines décision du nouveau ministre dans le droit fil de son action. "Je ne condamne pas à l’avance mon successeur, ses premières réformes ne sont pas mauvaises. J’aurais peine à dire le contraire, c’est ce que j’avais proposé". Fidèle à son image de franc-tireur, Bernard Kouchner fait part des difficultés qu’il a rencontrées pour se faire entendre dans ce gouvernement dans lequel il avoue ne pas avoir été "très heureux". La faute à la confiance indéfectible que lui accorde les Français au plus haut dans les sondages, "ma popularité l’irritait (Jospin), il ne m’a jamais trouvé légitime". Il n’en garde pas moins de l’estime et "même de l’amitié" à son égard, jugeant qu’il était "l’un des meilleurs premier ministre".
C’est peu dire que la santé n’a pas été le thème principal de la campagne présidentielle. La raison en est simple : le secteur est réputé "matière inflammable". Pourtant Bernard Kouchner juge que la gauche a failli dans ce domaine en confondant trop souvent le social avec la santé et a eu tort de l’aborder de façon trop technique, "comme un service plus que comme un problème de société". La leçon de l’opposition au plan Juppé de maîtrise comptable des dépenses de santé n’a pas été assimilée et les mêmes erreurs ont été reproduites par Martine Aubry, puis Elisabeth Guigou, les ministres des Affaires sociales successives. La consultation à 20 €uros réclamée par les médecin généralistes ? "J’ai toujours été favorable à cette revalorisation dès 1992", mais c’est Elisabeth Guigou qui est en charge du dossier. Le déremboursement des 835 molécules au SMR insuffisant ? "Je me suis heurté au ministère des Affaires sociales".
Mais l’une des explications majeures se trouve dans la volonté d’appliquer les 35 heures à l’hôpital, "une bonne idée mais trop théorique". D’autant que le gouvernement n’a pas suffisamment pris la mesure du problème posé par la démographie médicale et que "les hôpitaux n’ont rien à voir avec des entreprises, les malades ne font pas les 35 heures". Bernard Kouchner juge qu’il aurait été préférable de ne pas fixer le 1er janvier 2002 comme date butoir et de continuer à négocier plus longtemps et d’étaler leur mise en œuvre sur trois ou quatre ans. Résultat : "nos alliés électoraux naturels, les personnels hospitaliers, étaient pour une part devenu hostiles". Mais surtout il regrette que la réduction du temps de travail (RTT) ait servi de catalyseur du changement de mentalités et de l’esprit médical : les médecins se sont mis à compter leurs heures.
|
|
||||||||||||
| ss | 1 | ||||||||||||
|
Copyright © Medcost 2003-Tous droits réservés. |
|||||||||||||