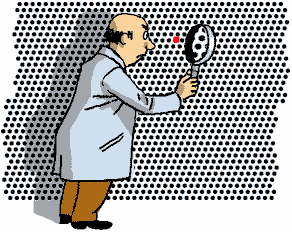|
33,
rue Raffet |

|
Le
recrutement des patients
1er février 2001 Le Téléthon a permis de rendre populaire en France une problématique qui, par nature, touche peu le grand public, celle des maladies rares. Ces maladies dont la prévalence ne dépasse pas 5 cas sur 10 000, intéressent peu les chercheurs et les laboratoires pharmaceutiques du fait des difficultés à rentabiliser les investissements nécessaires à la mise au point des médicaments (que l’on dit orphelins). Grâce aux 500 millions de francs de promesses de dons du Téléthon, l’Association Française contre les Myopathies prévoit un effort particulier en faveur des maladies rares pour lesquelles 148 demandes de programmes de recherches ont déjà été déposées.
Les maladies rares sont par définition si peu fréquentes que les coûts de la recherche et du développement ne sont pas amortis par la mise sur le marché du produit. Cette rentabilité fragile est accentuée par la non-brevetabilité des molécules issues du secteur pharmaceutique. Pour inciter les recherches, les Etats-Unis ont mis en place, dès 1983, des politiques d’incitation à la mise au point de médicaments orphelins (« Orphan Drug Act »), celles-ci ont permis le développement d’environ 900 médicaments. Des pratiques semblables ont vu le jour à partir de 1993 au Japon.
L’Europe, sans doute en raison de son morcellement étatique, reste en retard sur cette question. Compte tenu de la faible prévalence de ces maladies, une action communautaire est la plus appropriée (et surtout la plus viable) afin d’accéder à un marché le plus vaste possible. D’après le SNIP, il y aurait en Europe 4 à 5 000 maladies rares, qui toucheraient entre 25 et 30 millions de personnes sur une population globale de 370 millions de personnes. C’est dans cet esprit que le 04 février 1999, la Communauté européenne a adopté un programme concernant les maladies rares, visant à faciliter l'accès à l'information sur celles-ci, en particulier pour les personnes touchées, les professionnels de la santé et les chercheurs. Ce programme prévoit entre autres la création d’un réseau européen d’informations sur les maladies rares (notamment via l’Internet). Grâce au règlement n°141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments orphelins, les entreprises du secteur de la Santé peuvent désormais demander à l’Agence européenne de désigner, pour l’évaluation des médicaments (AEEM), certains de leurs médicaments comme « médicaments orphelins ». Ils bénéficient alors des avantages suivants :
Cette déclaration doit se faire avant le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché.
Pour les maladies orphelines, la recherche et le développement doivent bénéficier d’une qualité identique aux autres maladies. Compte tenu de la faible rentabilité des médicaments, il faut optimiser le cycle de développement du médicament en minimisant ses coûts. Le recrutement des patients devient dans ce contexte un enjeu important : les méthodes de recrutement classiques utilisées par les médecins participants aux études cliniques peuvent être associés à un recrutement sur Internet. Le laboratoire peut ouvrir un espace sur son propre site web, permettant aux médecins mais aussi aux patients de s’inscrire dans l’essai clinique. Il peut être également efficace de passer par des sites web associatifs tel que le site Orphanet en France qui touche une population très ciblée. Sur ce site, par exemple, il suffit de télécharger le formulaire de demande de mise en ligne de l’information se rapportant à l’essai clinique en fournissant les informations suivantes :
De plus, le site Orphanet permet aux médecins praticiens, mais également à toute personne concernée par les maladies rares, de trouver des informations pertinentes sur leur définition, leur histoire naturelle, leur mode de prise en charge, leur traitement et les lieux de prise en charge. On peut notamment faire des recherches :
Les sites portails grand public sur la santé, de par leur très fort niveau d’audience, pourraient également dans le futur participer à ce type de recrutement efficace. Des rubriques dédiées au recrutement des investigateurs et des patients pourraient se développer. Ces espaces pourraient proposer aux visiteurs du site, de l’information sur les essais cliniques concernant les maladies rares, avec un formulaire électronique d’inscription en ligne. Si les portails français n’ont pas encore développé ce type de projet, le procédé « d’appel public » au recrutement des patients est dores et déjà réglementé : il doit être mentionné et décrit au sein d’un dossier soumis au Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB) et un dossier de « déclaration d’un traitement automatisé d’informations nominatives » doit être déposé à la CNIL. Ce recrutement électronique permettra aux laboratoires pharmaceutiques de mieux évaluer les potentialités de développement de la recherche des médicaments orphelins…
De par son caractère universel, l’Internet est un média tout à fait adapté aux problèmes posés par les maladies rares : les professionnels de santé, les chercheurs, les malades et leur famille disposent là d’un outil unique dans l’histoire de la santé humaine. L’Internet rapproche les hommes (même si ce rapprochement se limite encore aux grands pays industrialisés) et créé des communautés mondiales de patients et de professionnels. Le volume induit par cette internationalisation devrait permettre aux laboratoires pharmaceutiques de mieux gérer leur recherche et développement en améliorant la rentabilité de ces médicaments orphelins.
Réagissez à cet article Retrouvez tous les autres articles et interviews de la rubrique Les essais cliniques en ligne. 1er février 2001
|
|
||||||||||||||||
| Copyright © Medcost 2003-Tous droits réservés. | |||||||||||||||||