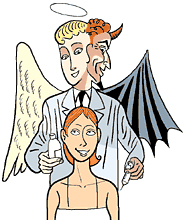|
33,
rue Raffet |

|
Loi Huriet : premier bilan…
15 mai 2001 Le 9 mai 2000 Claude Huriet, en sa qualité de rapporteur pour la commission des affaires sociales de la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, a fait état des neuf questions, restées sans réponse. Adressées au gouvernement depuis 1996 elles concernent le fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (CCPPRB). Dix ans après la mise en application de la loi, il était temps de réaliser un bilan sur le fonctionnement des CCPPRB, afin d’être en mesure d’avancer des propositions d’amélioration pour la révision des lois dites «bioéthiques». Un an plus tard, au cours de la réunion de la commission des affaires sociales du 4 avril 2001, Claude Huriet a établi une image très précise du paysage concernant l’activité des structures mise en place suite à l’adoption de la loi du 20 décembre 1988 grâce aux réponses issues d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des comités, accompagné d’un programme d’auditions (voir Rapport d’Information fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale). Les enseignements pratiques de la mission La première constatation concerne le manque de précision des statistiques disponibles. Ainsi, il y a eu 2280 avis rendus par les comités en 1999 (63% des avis ont été demandés par des industriels contre 37% par les personnes physiques ou les organismes sans but lucratif). 78% de ces avis concernaient des médicaments, 10% des dispositifs médicaux, 9% des recherches cognitives et 3% des recherches en psychologie. En revanche, il est par exemple impossible de connaître le nombre de recherches en cosmétique. Plus grave, Claude Huriet a estimé que des doutes subsistaient quant à l’application de la loi pour certaines recherches comme les études épidémiologiques nécessitant un prélèvement sanguin. Il est également apparu que les comités comme les promoteurs rencontrent des difficultés pour qualifier les essais « avec » ou « sans » bénéfice individuel direct. A cette redéfinition des termes, il est actuellement nécessaire d’établir un recueil des positions adoptées par les divers comités afin d’établir une sorte de « jurisprudence » pour la recherche biomédicale en France. Cette consultation nationale a également permis de mieux percevoir la préoccupation des fabricants de dispositifs médicaux qui doivent fournir gratuitement les dispositifs nécessaires à la recherche (cette situation pénalisant le développement de la recherche clinique en France). Les défaillances propres à l’organisation des comités Claude Huriet a également constaté que la qualité du fonctionnement des CCPPRB était fonction du pluralisme de leur composition. La présence de certaines catégories de membres était loin d’être assurée dans nombre de comités (notamment suite à un nombre élevé de démission, à l’absence de formation des membres, ainsi qu’à l’absence de rémunération des professionnels de santé libéraux). D’autre part, cette enquête a permis de réaliser que certains comités ne se bornaient pas à donner un avis mais qu’en amont ils acceptaient un rôle de conseil, au bénéfice de la qualité des essais cliniques. Cette analyse a également permis de voir que le nombre de demande d’amendements aux protocoles est de plus en plus fréquent, situation gênante si elle devait amener les comités à consacrer moins de temps à l’examen des protocoles. Enfin, la forte variation du nombre d’avis rendus par certains comités par rapport à d’autres, malgré cette loi du 20 décembre 1988 commune, avaient pu laisser craindre la création d’un «Gault-Millau» des CCPPRB. Les relations entre les comités et les pouvoirs publics Le suivi des comités par la direction générale de la santé (DGS), malgré la récente réforme de ses services, ne semble pas satisfaisante. En effet, la procédure d’affectation des moyens budgétaires aux comités est particulièrement opaque. Initialement, le financement des comités reposait sur une redevance payée par les promoteurs pour chaque protocole et en contrepartie, les crédits étaient redistribués aux comités en fonction du nombre d’avis rendu (mode mécanique mais transparent). Depuis 1998, les modalités de répartition ont été modifiées, la DGS retenant désormais deux critères : les charges salariales et de fonctionnement et la situation des comités au vu des comptes de résultats et des bilans financiers (mode souple mais opaque). Cette réforme du financement s’est traduite également par un accroissement de l’écart entre le montant total des redevances et les sommes globales distribuées aux comités, les crédits non distribués étant reportés d’année en année sur le fonds de concours correspondant. Pour Claude Huriet, cette situation nécessite une « remise à plat » urgente des modalités de financement des CCPPRB. Les propositions de Claude Huriet A l’issu de cette consultation, Claude Huriet a donc proposé de revenir sur les points suivants :
L’ensemble de ces propositions devrait se traduire par une évolution des textes réglementaires d’une part et par des modifications législatives d’autre part. La révision des lois dites de « bioéthique », qui aurait dû intervenir dès juillet 1999, pourrait être l’occasion de débattre de ces dernières. Le conseil des ministres devrait étudier ce dossier durant la première semaine de juin prochain et la loi être discutée à la rentrée de septembre. Réagissez à cet article Retrouvez tous les autres articles et interviews de la rubrique Les essais cliniques en ligne. 15
mai 2001
|
|
|||||||||||||
| Copyright © Medcost 2003-Tous droits réservés. | ||||||||||||||