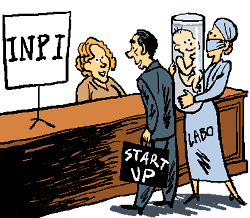|
33,
rue Raffet |

![]()
|
La brevetabilité du vivant
15 mars 2001 Le droit français prévoit que les « inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle » peuvent bénéficier de la protection par un brevet. Les trois conditions énoncées doivent donc être réunies :
Un
brevet d’invention donne à son titulaire le droit d’interdire aux
tiers d’exploiter à des fins commerciales ou industrielles l’invention
brevetée. Le titulaire pourra également concéder des licences d’exploitation
du brevet. Le brevet présente donc, au-delà de sa fonction de sécurisation
et de son intérêt scientifique, industriel ou de marché, une fonction
économique. Si les conditions de la brevetabilité des médicaments en général sont donc fixées par le Code de la propriété intellectuelle, le développement des biotechnologies, et dans ce cadre des médicaments issus des biotechnologies agite la question éthico-juridique majeure de l’appropriation du vivant et oppose des intérêts apparemment différenciés : la protection des libertés fondamentales, et dans ce cadre la non-commercialité du corps humain, d’une part, les exigences d’amélioration de la santé publique et donc de la nécessité d'une recherche fondamentale de pointe d’autre part, et enfin, l’impératif de protection juridique des résultats scientifiques.
Dans
ce contexte, et après avoir été malmenée par les opposants à la
« brevetabilité du vivant », le 6 juillet 1998, le législateur
européen est parvenu à voter une Directive relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques.
Bill
Clinton, Tony Blair ou même Jacques Chirac ont « interpellé »
les acteurs clef de la recherche génétique et les ont exhorté à
mettre à la disposition de tous les résultats des recherches génétiques
et donc du séquençage du corps humain. Ces appels constituent une
remise en cause indirecte du principe de la non appropriation du
vivant par le brevet, confirmée par un récent
rapport du Comité Consultatif National d’éthique. Rappelant
l’un des principes des lois bioéthiques de 1994 : « le
corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance
de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent,
en tant que tels, faire l'objet de brevets ". Réagissez à cet article. Retrouvez tous les autres articles de la rubrique e-Droit. 15 mars 2001
|
|
||||||||
| 1 | |||||||||
|
|
|||||||||
Copyright © Medcost 2003-Tous droits réservés.