|
Gilles Poutout
URCAM Ile-de-France
|
|
|
|
"
Sur les 25 dossiers qui ont reçu des fonds du FAQSV
IdF en 2000, 18 sont des projets de coordination des soins
".
|
|
Propos
recueillis par Dominique
Etienne et Corinne
Radal
24 avril
2001
 Quel
est votre rôle à l'Urcam Idf ? Quel
est votre rôle à l'Urcam Idf ?
L'Urcam
est une petite structure puisque nous sommes 13 en tout, du secrétariat
au directeur et chacun doit donc faire preuve de beaucoup de polyvalence.
Cela dit, je m'occupe particulièrement des nouvelles modalités
d'organisation de la médecine et des soins de ville, notamment
des réseaux de soins ainsi que du Fonds d'Aide à la
Qualité des Soins de Ville (FAQSV).
 Comment est né le Comité Régional des Réseaux
Idf ?
Comment est né le Comité Régional des Réseaux
Idf ?
Dès
la fin 1998, soit peu après la création de l'Urcam,
le Conseil d'Administration s'est fixé comme l'une de ses
priorités l'aide au développement et l'accompagnement
des réseaux de soins. Cela fait désormais plus de
2 ans que nous travaillons d'arrache-pied là-dessus. Et nous
avons été pionniers dans la constitution de ces comités
régionaux.
 Pourquoi
de tels comités ? Pourquoi
de tels comités ?
La
1ère fois que le terme "réseau de soins"
apparaît dans le vocabulaire administratif, c'est à
l'occasion d'une circulaire de juin 1991, relative à la prise
en charge des patients atteints du SIDA. Il s'agissait surtout à
ce moment-là de réseaux hôpital-ville. Les ordonnances
de 1996 ont ensuite créé de nouvelles possibilités.
Il y a eu beaucoup d'espoir autour des réseaux expérimentaux,
mais très peu de concrétisations parce que la procédure
dérogatoire (dite procédure Soubie) était extrêmement
compliquée. Bref, le paysage était assez flou, mais
en même temps nous voyions bien que sur le terrain il y avait
des germes d'organisations, beaucoup de gens qui réfléchissaient
…Il fallait donc essayer de les accompagner, et c'est pourquoi
a été créé ce Comité Régional
des Réseaux (CRR), qui fonctionne depuis octobre 1999.
Ce fut d'abord une réflexion interne aux institutions (ARH,
assurance maladie, …), qui a été très
vite élargie aux libéraux avec l'URML et aux hospitaliers.
 En
quoi consiste le travail du CRR ? En
quoi consiste le travail du CRR ?
L'identification
des réseaux était la première étape.
De multiples chiffres circulent sur le nombre de réseaux
existants. En Ile-de-France, par exemple, selon la définition
donnée, on peut en compter plusieurs centaines, ou quelques
dizaines, ou même aucun si l'on ne retient que ceux ayant
obtenu l'agrément ministériel. Il a donc fallu se
mettre d'accord sur une perception commune des réseaux. Nous
y avons consacré du temps, car nous n'avions pas tous spontanément
la même vision (l'ARH et les fédérations hospitalières
voyaient les réseaux plutôt à travers les hôpitaux,
l'URCAM et l'URML plutôt à travers les libéraux
…).
A
partir de quelques rubriques indispensables (objectifs, organisation
du dispositif de soins, notamment la coordination, nature juridique,
dimension économique, évaluation), nous avons listé
toute une série de questions que doivent se poser les promoteurs
de réseaux dans une perspective de pérennité
et d'efficacité. C'est ainsi que nous avons bâti le
"dossier promoteur". Ce dossier doit être pris pour
ce qu'il est : une liste de questions que tout promoteur doit se
poser tôt ou tard dans la mise en place d'un réseau.
Ce dossier promoteur constitue néanmoins la trame permettant
d'avoir une vision commune sur les projets répondant à
des besoins avérés en apportant une valeur ajoutée.
Plus
de 30 projets ont été analysés dans cet esprit
par le CRR. Cela va permettre de finaliser dans les semaines à
venir un premier annuaire des réseaux d'Ile de France, qui
sera mis à disposition sur le site de l'Urcam idf. Un tel
annuaire va représenter un réel progrès car
il contient de véritables critères d'identification
des réseaux. Nous avons néanmoins conscience qu'il
ne s'agit encore que d'une première étape, dont il
faut souligner la non exhaustivité.
 Qu'en est-il du FAQSV ?
Qu'en est-il du FAQSV ?
Le
FAQSV est une possibilité financière, qui permet de
soutenir les projets de libéraux qui ont comme visée
générale d'améliorer la qualité des
soins. C'est à la fois très vaste et très limité
car les fonds sont exclusivement destinés aux libéraux
et ne peuvent en aucun cas concerner la prise en charge directe
des patients.
Le FAQSV est cogéré par l'assurance maladie et les
professionnels. Il existe un comité national de gestion pour
les projets d'ampleur nationale, et un comité régional
dans chaque région, où siègent 29 personnes
représentant les différents acteurs de la santé.
Ce comité définit les conditions d'attribution des
aides : qu'est-ce qui est éligible en fonction de la loi,
quelles sont les actions à privilégier…
Au sein de chaque comité a été créé
un bureau de gestion, composé de 6 personnes : 3 administrateurs
de l'Urcam (dont le président), 2 représentant les
professionnels de santé dont un représentant les établissements,
et 1 personnalité qualifiée. Ce bureau attribue les
fonds sur la base de l'étude des dossiers qui lui sont soumis
et en fonction des orientations du comité régional
de gestion. Il se réunit tous les 2 mois en Ile-de-France.
 Quelles sont les exigences en matière d'évaluation
des réseaux ?
Quelles sont les exigences en matière d'évaluation
des réseaux ?
Dans
le cadre du FAQSV, l'évaluation constitue l'une des principales
exigences pour l'obtention des aides. Si le promoteur ne s'engage
pas à produire un bilan de l'action, réalisé
par un évaluateur externe, le projet ne peut pas être
accepté.
Plus généralement, la première exigence en
matière d'évaluation des réseaux consiste pour
le promoteur à définir une méthodologie qui
permette d'abord de s'assurer à tout moment du fonctionnement
du dispositif tel que prévu, ensuite de valider la plus-value
apportée par le réseau.
Concrètement, nous demandons au promoteur de définir
un budget prévisionnel et surtout de décrire les mécanismes
qui vont lui permettre de suivre le plus fidèlement possible
le coût d'une prise en charge. Cela étant, nous n'exigeons
pas forcément qu'il s'engage à réaliser des
économies par rapport au coût supposé d'une
prise en charge hors réseau. Tout dépend de la nature
et de l'étendue du réseau.
Nous demandons également qu'une méthodologie d'évaluation
médico-économique soit prévue. C'est une condition
sine qua non. Avec des adaptations bien sûr, selon la nature
des projets. Dans certains cas, l'évaluation portera beaucoup
plus sur le volet médical ou organisationnel, et dans d'autres
cas, plus sur le volet économique. Pour un projet extrêmement
ciblé répondant à un besoin de santé
localisé et spécifique, on ne va pas forcément
demander une évaluation économique affinée.
Cela n'aurait pas de sens. Par contre, d'autres projets se justifient
principalement par les économies escomptées.
 Comment se déroule l'examen des dossiers par le CRR ?
Comment se déroule l'examen des dossiers par le CRR ?
A
partir du moment où le dossier est déposé officiellement,
nous déclenchons " l'audit " du réseau.
Un binôme de 2 auditeurs indépendants étudie
alors le dossier. Ce binôme est à la fois médico-administratif
et professionnel/institutionnel : si le médecin est un médecin
libéral ou hospitalier, l'administratif sera forcément
un administratif institutionnel (Cram, Ddass) ; inversement si le
médecin est institutionnel (médecin-conseil ou médecin
inspecteur de la santé), l'administratif sera un administratif
hospitalier ou membre d'une structure professionnelle.
Ce binôme analyse le dossier avec une grille de lecture publique,
établie par le CRR. Elle est construite sur la même
trame que le dossier promoteur, les questions sont simplement un
peu plus précises.
Au plus tard 10 jours avant la date de réunion du CRR, les
auditeurs remettent leur mémoire, qui est transmis simultanément
au promoteur et à chaque membre du CRR. Lors de la réunion
du comité (environ tous les 2 mois), les auditeurs rappellent
leurs principales observations aux membres du CRR ; le promoteur
présente son projet s'il le souhaite et répond aux
questions qui lui sont posées. Il y a un grand débat,
à l'issue duquel le comité prend position. Jusqu'à
présent, le CRR a rarement rendu un avis négatif ;
ce sont plutôt des avis circonstanciés avec des recommandations
et, parfois, des réserves ou des points à résoudre
absolument. A partir du moment où un avis favorable est donné,
il engage l'ensemble des partenaires de santé représentés
à aider le réseau.
Avec cette procédure, tout le monde acquiert un certain nombre
de réflexes, les professionnels promoteurs comme les institutionnels,
et on voit émerger un langage et une expertise partagés.
 Comment se positionne le FAQSV par rapport à ce processus
?
Comment se positionne le FAQSV par rapport à ce processus
?
Le
secrétariat du CRR et celui du FAQSV sont assurées
par la même personne, ce qui nous permet de relier les dossiers.
Quand un projet de réseau a reçu l'aval du CRR, nous
informons le promoteur sur les subventions disponibles et sur ce
qui est éligible au FAQSV pour l'aider à financer
le projet.
Toutefois, un dossier réseau peut être présenté
au FAQSV sans être passé par le CRR, notamment lorsque
des libéraux ont besoin d'aide en termes d'ingénierie
pour le montage de projet. Dans ce cas, nous demandons dans la convention
conclue avec le promoteur de présenter un dossier au CRR
pour juger de la pérennité du projet.
 Combien de dossiers ont été examinés, et combien
ont eu des fonds du FAQSV Ile de France ?
Combien de dossiers ont été examinés, et combien
ont eu des fonds du FAQSV Ile de France ?
Une
trentaine de projets de réseaux ont été analysés
par le CRR.
Pour ce qui est du FAQSV, 54 millions de francs ont été
attribués à l'Ile-de-France en 2000, sur une enveloppe
nationale de 500 millions de francs. Nous avons reçu 40 dossiers.
Le bureau a finalement passé convention avec 25 promoteurs.
Sur ces 25 projets, 18 sont des projets de coordination ou de réseau,
les 7 autres ont trait à l'amélioration de la qualité
des soins (audits, études …). Cette proportion 18/7
est à peu près ce que nous avions prévu au
départ. 46 millions ont été engagés
par le FAQSV pour aider ces 25 projets, soit 85% de l'utilisation
du fond.
En fait, sur ces 46 millions engagés, nous n'avons dépensé
en 2000 qu'à peu près 8 millions de francs sous forme
d'acompte. En effet, le FAQSV fonctionne sous forme d'enveloppe
annuelle sans mécanisme de report d'une année sur
l'autre : nous n'avons versé sur les crédits 2000
que ce qui a été engagé par les promoteurs
en 2000. Le reste sera payé sur l'enveloppe 2001. Ainsi,
cette année, sur une dotation de 83 millions de francs, 38
millions de francs sont déjà hypothéqués.
 Qu'en est-il de la transparence sur l'allocation des fonds ?
Qu'en est-il de la transparence sur l'allocation des fonds ?
Il
y a de la part des membres du FAQSV une forte volonté de
transparence. Au sein du Comité régional de gestion,
il y a beaucoup de partenaires, qui ont le droit, voire le devoir,
de communiquer !
Pour ce qui est de notre région, la transparence a été
totale et la communication a été aussi rapide que
possible. A partir du moment où les décisions sont
notifiées et validées, elles deviennent publiques.
Avant décision, tous les membres du bureau sont tenus au
" secret de l'instruction ".
Les décisions du bureau du FAQSV vont être publiées
sur notre site Internet, comme l'annuaire que nous prévoyons
: qui fait quoi, dans quel domaine, à quel endroit …
Les seuls éléments qu'il est impossible de dévoiler
concernent le fond des dossiers (qui relève de la propriété
intellectuelle) et les clauses conventionnelles conclues entre les
partenaires.
Au niveau national, il est encore trop tôt pour organiser
une communication générale. En effet, les fonds 2000
n'ont été disponibles qu'au dernier trimestre ! Les
orientations régionales ont été définies
pour la plupart en octobre ; les bureaux ont commencé à
examiner les dossiers fin octobre, début novembre ; et les
conventions ont ensuite été passées en toute
fin d'exercice.
Il s'agit maintenant de centraliser toutes les données à
partir des rapports officiels des comités régionaux
de gestion pour en faire une synthèse, et cela prend du temps.
 Qu'en est-il des autres régions où ont été
instaurés des comités ? Comment expliquez-vous les
disparités observées ?
Qu'en est-il des autres régions où ont été
instaurés des comités ? Comment expliquez-vous les
disparités observées ?
Dans
la mesure où le FAQSV est un fond régionalisé,
il y a forcément des différences entre régions.
Il faut savoir ce que l'on veut : on ne peut pas régionaliser
le système, et en même temps vouloir que tout soit
homogène !
Il y a des orientations nationales : améliorer la qualité
des soins de ville en prenant appui sur quelques grandes idées
(évaluation des pratiques, coordination, mise en réseau
…) qui servent de cadre politique. Après, chaque région
se focalise sur certains points, sur les problèmes concrets,
identifiés par les acteurs régionaux.
La procédure a bien fonctionné dans la moitié
des régions, à des degrés divers bien entendu.
Dans certaines régions, il existe des contextes difficiles,
il a pu y avoir des problèmes de coordination entre acteurs,
etc … Une fois de plus, le FAQSV n'est entrée en vigueur
qu'il y a… moins de 6 mois !
Il faut tirer des leçons des choses qui avancent. Il faut
désormais lancer l'évaluation de ce qu'on fait au
FAQSV ou au CRR. D'ailleurs, quand nous avons mis le CRR en place,
nous en avons informé tous nos partenaires (Ministère,
Caisses nationales d'assurance maladie, …). Nous souhaitons
appliquer à nous-mêmes ce que nous préconisons
aux autres : il faut évaluer (pourquoi ça marche,
est-ce que c'est reproductible, comment gère-t-on cette reproductibilité...).
 Que pensez-vous de l'introduction des NTIC dans les réseaux
de soins ?
Que pensez-vous de l'introduction des NTIC dans les réseaux
de soins ?
On
ne va pas enfoncer des portes ouvertes : les technologies de l'information
c'est évidemment un grand progrès, et il faut s'y
investir à fond et vite. Ce que je regrette, c'est le manque
de transparence du côté des offreurs, on ne sait pas
vraiment qui fait quoi … Il existe certes des outils puissants,
mais pour moi l'offre n'est pas claire, et j'ai le sentiment que
personne ne contribue actuellement à la clarifier.
De quoi a besoin un médecin ? C'est la question qu'il faut
se poser. Par exemple, concernant l'information sur Internet, je
vois des médecins qui vont surfer sur des sites aux Etats-Unis
: ils auront des informations sans doute passionnantes, mais que
vont-ils en faire dans la réalité de leur pratique
?
Il faut désormais organiser très vite un débat
sur l'état des lieux de l'offre disponible pour les professionnels
de santé, qualitatif et quantitatif et, bien sûr, public.
Réagissez
à
cette interview.
Retrouvez toutes
les autres interviews.
24
avril 2001
|
 |
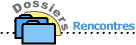
|

![]()

