Décembre
2000
Claude
Le Pen
Economiste
de la santé
Université Paris-Dauphine
|
 |
"
Les dépenses de santé vont continuer à croître (..)
c’est une bonne chose ! " |
|
Propos recueillis
par Mathieu
Ozanam
 Les premiers réseaux sont apparus dans les années 80 et les ordonnances
de 1996 leur ont donné un cadre, mais on continue aujourd’hui à
ne pas très bien percevoir quelle est la place des réseaux dans
le système de santé ?
Les premiers réseaux sont apparus dans les années 80 et les ordonnances
de 1996 leur ont donné un cadre, mais on continue aujourd’hui à
ne pas très bien percevoir quelle est la place des réseaux dans
le système de santé ?
Il
y a une grande différence entre les expériences spontanées de
réseaux des années 80 qui répondaient à des impératifs de santé
publique, et les réseaux des ordonnances de 1996.
Dans
le premier cas, il s’agissait essentiellement de réseaux ville-hôpital
orientés sur quelques thèmes : sida, maintien à domicile
de personnes âgées, toxicomanie. En résumé des ambitions très
ciblées et des initiatives individuelles des médecins qui répondent
aux besoins de leurs patients. Par nature ces patients font l’aller-retour
entre les soins de ville et hospitaliers. Il était donc difficile
de les suivre dans le système de santé habituel, en ce sens une
prise en charge coordonnée était donc une bonne réponse.
L’intention
du législateur de 1996 était toute différente puisqu’il y avait
la volonté de changer les bases du système de santé, en coordonnant
mieux l’effort global à l’échelle de la nation. Il s’agissait
aussi de répondre à l’une des revendications de MG-France :
le médecin référent, sorte de gate-keeper à la française, qui
aurait mis fin à l’accès direct aux spécialistes. La CSMF proposait
plutôt de créer des réseaux horizontaux mettant l’accent sur la
coordination des soins, en particulier des soins de généralistes
et de spécialité. Le contexte était donc plus politique et la
réforme plus ambitieuse. Le législateur n’a pas voulu trancher
entre les filières et les réseaux et la voie expérimentale est
apparue comme une manière élégante de contourner le problème.L’autre
idée était de décentraliser en confiant davantage de pouvoir aux
acteurs conventionnels, notamment les caisses d’assurance maladie.
Mais, dans le temps on a ressenti une certaine méfiance avec la
création d’un dispositif d’agrément très lourd nécessitant l’accord
obligatoire d’une caisse d’assurance maladie, le vote de son conseil
d’administration, l’aval du comité d’orientation des filières
et réseaux de soins expérimentaux et enfin l’agrément du ministre.
 Cette institutionnalisation des réseaux n’a-t-elle pas tari les
bonnes volontés ?
Cette institutionnalisation des réseaux n’a-t-elle pas tari les
bonnes volontés ?
Elle
était certainement trop forte. L’alternance politique a aussi
joué son rôle. La majorité qui a imaginé la politique de réseaux
et celle qui a eu à la mettre en oeuvre n’était pas du même bord.
La nouvelle majorité n’a pas vraiment assumé ces réseaux. Le ministre
des affaires sociales n’a jamais fait référence dans quelque
discours que ce soit, aux filières et réseaux. Pour autant ils
n’ont pas été reniés non plus. La situation politique a donc été
très ambiguë.
Et puis
la pression de l’assurance privée a refroidi les ardeurs du nouveau
gouvernement, en particulier les déclarations de Claude Bébar,
président d’Axa, au sujet la possibilité de mener une expérience
de prise en charge globale du remboursement de ses assurés d’
Ile-de-France au premier franc. Les choses se sont donc enlisées
sous l’effet combiné de ces menaces réelles ou supposées, de la
lourdeur du processus administratif et du manque d’enthousiasme
politique. Le plus étonnant finalement c’est que le thème survive
en dépit de ces lourds handicaps.
 Comment relancer les réseaux ?
Comment relancer les réseaux ?
La
régionalisation du dispositif est un acquis de la nouvelle loi
de modernisation du système de santé. Tout le monde est à peu
près d’accord pour que la plupart des réseaux soient décentralisés.
On ne voit pas pourquoi il faudrait que tous les responsables
nationaux de la santé se réunissent, à Paris, au ministère, pour
décider de l’avenir d’un réseau de soins palliatifs de 200 patients
dans l’Ariège.
Parallèlement
à ce mouvement un troisième type de réseau, aux fondements très
locaux, a été impulsé par les ARH depuis 2-3 ans avec des groupes
de médecins, en dehors du contrôle du comité Soubie. Ils font
la promotion, non sans arrières-pensées, des nouveaux rapports
entre la ville et l’hôpital, avec l’idée que l’hôpital, un peu
à l’étroit dans son budget global, a intérêt à déshospitaliser
ses patients tout en en gardant le contrôle.
Du côté
des médecins libéraux et des URML, j’ai constaté que l’attitude
face aux réseaux avait changé. La victoire de la CSMF aux dernières
élections lève l’hypothèque sur le devenir du médecin référent
et sur les menaces de l’accès direct aux spécialistes. Une notion
du réseau conçue défensivement comme un barrage aux projets de
filières n’est donc plus d’actualité..
Les
médecins ont par ailleurs mal vécu la surenchère bureaucratique.
Ils ont buté sur la lourdeur du parcours administratifs perçu
comme une sommes de contraintes et de contrôles. L’image des réseaux
chez le médecin de base est donc devenue au fil du temps plutôt
négative. Il y a donc eu un retournement d’opinion que l’on peut
regretter, les professionnels de santé considérant dorénavant
les réseaux comme étant une menace pour l’indépendance des médecins.
 Le docteur Didier Ménard de la Coordination Nationale des Réseaux
parle d’usine à gaz à propos du Comité Soubie. Vous avez vous-mêmes
admis qu’il était en sommeil, quel bilan dressez-vous de son
action depuis 3 ans et quel peut être son avenir ?
Le docteur Didier Ménard de la Coordination Nationale des Réseaux
parle d’usine à gaz à propos du Comité Soubie. Vous avez vous-mêmes
admis qu’il était en sommeil, quel bilan dressez-vous de son
action depuis 3 ans et quel peut être son avenir ?
La
bureaucratie n’est pas le fait du comité Soubie, qui a été mis
en place par la loi, mais de Juppé. De manière générale, la
jurisprudence du Comité a été au contraire plutôt libérale en
essayant de préserver le plus possible « l’intérêt à expérimenter ».
Il a été sérieux dans ses évaluations, mais jamais tatillon
et il a plutôt respecté les promoteurs, en procédant par exemple
à des auditions qui sont devenues systématiques. Je ne me reconnais
pas et je ne reconnais pas le Comité dans ces critiques. Par
ailleurs, les agréments ont été donnés au compte-goutte par
un gouvernement très ambigu sur cette question, comme nous le
disions, mais là encore ce n’est pas de notre fait.
 Et quel avenir pour le comité ?
Et quel avenir pour le comité ?
Dans
sa forme actuelle il va certainement disparaître. La question
qui se pose est de savoir si nous avons besoin d’un organe
national de coordination et de réflexion sur les réseaux. Je pense
que oui, et nous verrons ce qu’en pensent le législateur et le
premier ministre. Je ne crois pas qu’il faille au plan national
un organe de décision et d’agrément, plutôt un organe d’arbitrage,
de réflexion stratégique, qui pourrait en outre s’occuper de quelques
projets particuliers par leur ampleur ou par leurs implications.
Je pense par exemple au projet innovant de Lens qui possède des
caractéristiques un peu atypiques par rapport aux réseaux. Mais
dans 80% des réseaux il ne s’agit que de donner des exemptions
de ticket modérateur, d’autoriser des paiements par forfait, d’échanger
quelques informations entre médecins et la portée des mesures
dérogatoires est limitée.
20
novembre 2000
|
 |
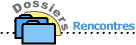
|
![]()
![]()

![]()
![]()

